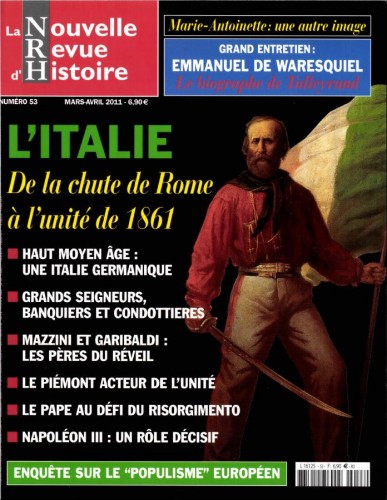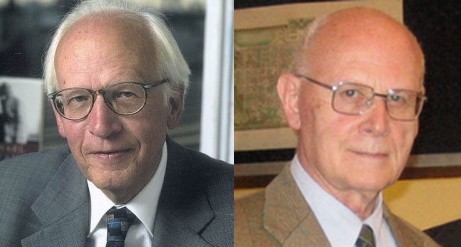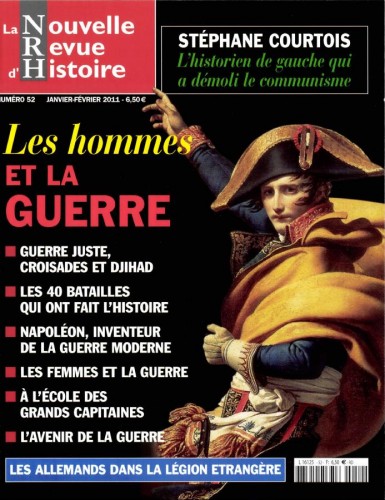Violence et « doux commerce »
La violence n’est pas seulement celle des armes. Depuis un demi-siècle, s’est imposé un système mondial, celui du « doux commerce ». Doux comme les bombes. Il domine les peuples sous les apparences de la démocratie, brisant les coutumes les plus sacrées. Décryptage d’une nouvelle violence qui règne grâce à la drogue de la consommation et à la repentance. Elle rencontre pourtant des résistances.
Georges Sorel est célèbre pour avoir publié en 1906 des Réflexions sur la violence (Librairie Marcel Rivière), souvent rééditées (1). Partisan du socialisme révolutionnaire, lu par Lénine et Mussolini, Sorel se faisait l’apologiste de la violence comme moteur de l’histoire.
Dans son essai, il s’inquiétait d’une anémie de la violence sociale qu’il croyait observer en Europe occidentale et aux Etats-Unis : «L’éducation est dirigée en vue d’atténuer tellement nos tendances à la violence que nous sommes conduits instinctivement à penser que tout acte de violence est une manifestation d’une régression vers la barbarie. […] On peut se demander s’il n’y a pas quelque niaiserie dans l’admiration de nos contemporains pour la douceur.» Ces remarques, datant d’un siècle, pourraient sembler d’aujourd’hui. Cela retient l’attention et intrigue.
Moins de dix ans après le constat morose de Sorel, commençait une Grande Guerre qui manifesta bien autre chose qu’un penchant général pour la douceur. Cette guerre fut suivie en Russie et en Europe d’une série de révolutions et de guerres civiles, dont le trait dominant ne fut pas la tranquillité. Et la Seconde Guerre mondiale qui se déchaina ensuite, assortie de séquelles comme la généralisation du terrorisme, ne fut pas non plus la manifestation de tendances paisibles.
L’Europe en dormition et en repentance
Cela pour dire que l’on s’égare souvent dans les prévisions en imaginant l’avenir comme le prolongement du présent. Sous l’effet d’émotions ou de commotions collectives inattendues, la douceur ou la mollesse d’une époque peuvent se muer soudain en violence irrésistible. L’histoire des peuples et des sociétés n’est pas régie par une loi de continuité, mais par d’imprévisibles accidents.
Dans l’Europe actuelle (mais pas ailleurs), tout laisserait supposer qu’a été mis un terme définitif à l’histoire, à ses violences et au politique. Ceux qui ont lu notre Siècle de 1914 savent que nous avons interprété l’époque qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, comme une entrée en dormition de l’Europe après un demi-siècle de folies violentes. Cette dormition n’est pas étrangère à une entreprise de culpabilisation et de démoralisation sans précédent. Avec courage et lucidité, cela fut analysé en 2003 par des intellectuels qu’inquiétait la montée en France de l’antisémitisme dans l’immigration maghrébine. Selon ces auteurs, l’immigration avait été favorisée par certains Juifs qui, « faisant un contresens tragique, ont cru à une alliance possible entre l’affirmation identitaire juive et la célébration des minorités et des localismes, bref, de “l’Autre” contre la nation (2) ». C’était reconnaître que l’intense propagande immigrationniste avait été une erreur. Mais, disaient les auteurs, il fallait remonter aux années soixante, pour chercher les racines de la démoralisation française et européenne, quand le souvenir de la « Shoah s’est imposé comme […] repère décisif d’une culpabilité qui ne concerne pas seulement les nazis mais […] un peu tout le monde en Europe, les peuples dans leur ensemble. » Depuis, « la Shoah barre aux peuples d’Europe toute espérance historique et les enferme dans le remord. » Inquiétant constat. Cinquante ans après, les Européens sommeillent toujours, écrasés de remords, comme « interdits d’histoire ». Pour combien de temps ? Voilà ce que nous ignorons. Mais cela ne saurait être éternel.
Rêves de bonheur, « doux commerce » et violence
En Europe, la fin provisoire de l’histoire et les rêves hédonistes ne peuvent être isolés d’une discours public nourri par le mythe du «doux commerce» inventé jadis par Adam Smith.
Quels ont été ses effets pratiques sur l’histoire vécue ? L’expérience des deux derniers siècles montre que le « doux commerce » est rarement une garantie contre la violence. Il l’est d’autant moins qu’il a remplacé le politique (la raison) par la morale (l’émotion). L’émotion fait vendre plus que la raison. Mais, au-delà des rêveries, elle est souvent pourvoyeuse de tueries, comme on l’a vu lors des guerres de Religion, puis des guerres idéologiques du XXe siècle.
En dépit des promesses d’Adam Smith, l’exercice intensif du « doux commerce » à l’échelle mondiale s’est ainsi accompagné de violences peu modérées. Si l’on adopte comme repère le XIXe siècle, on pensera entre autres aux guerres de l’Opium (1840-1842, 1858, 1860) qui associèrent la France et la Grande-Bretagne dans la volonté de forcer les frontières de la Chine. Il fallait ouvrir celle-ci à la morale biblique et à quelques bienfaits tels que le trafic de l’extrait de pavot ou la destruction de traditions millénaires. Réalisées au profit du « doux commerce », les interventions armées franco-britanniques conduisirent, par voie de conséquences, à ces nouveautés que furent, pour la Chine, les révolutions en chaîne, préludes aux grandes tueries du maoïsme (3).
Au bénéfice du « doux commerce » on peut encore inscrire nombre d’autres conflits coloniaux ou interétatiques. Y figurent en bonne place les deux guerres mondiales, dont les mobiles économiques ne furent pas minces (4). Etendre au monde entier l’exigence anglo-américaine du « free market » ne s’est pas fait sans un peu de casse… L’un des plus récents épisodes de ces dégâts, masqué de justifications morales et démocratiques (pléonasme), est la guerre d’Irak qui se poursuit depuis 2003. Le contrôle d’une source importante d’hydrocarbures nécessaire au « doux commerce » justifiait probablement que l’on mette à feu et à sang un pays, peut-être assez rugueux (il y en a d’autres), mais stable.
Logique interne du « doux commerce »
Depuis qu’il s’est mondialisé vers la fin du XXe siècle, on doit cependant reconnaître à l’avantage du « doux commerce » une plasticité et une capacité de survie que peu de systèmes sociaux ont possédé à ce point.
On a compris que le « doux commerce » est l’enveloppe qui recouvre des notions abstraites telles que «capitalisme» ou «libéralisme». Mais comme celles-ci ont servi à beaucoup de cuisines indigestes, leur signification s’est épuisée. Une autre notion, plus récente, est celle de « cosmocratie ». Elle est due à des auteurs américains, et fut reprise par Samuel Huntington dans son ultime essai Que sommes-nous ? (5). J’en ai moi-même fait usage. Elle est explicite. Elle suggère le caractère d’oligarchie mondialiste acquis peu à peu par le système depuis les années soixante du XXe siècle (6).
Mais restons-en pour le moment à la logique interne du « doux commerce ». Quel est son but ? C’est le profit individuel et financier de ses bénéficiaires, quel qu’en soit le prix pour les autres. Etant devenu dominant dans nos sociétés, cet objectif a été promu au rang de valeur suprême, apte à tout justifier, notamment ce qui était naguère condamné par le sens commun et la morale sociale la plus élémentaire. Dans son Manifeste de 1848, Karl Marx avait décrit avec pertinence l’aptitude destructrice illimitée du système qu’il assimilait à la « bourgeoisie », quand bien même le comportement personnel de maint bourgeois contredisait la thèse. Rappelons pour mémoire ses lignes célèbres : « Partout où elle a pris le pouvoir, la bourgeoisie a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt […]. Ce constant ébranlement de tout système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. »
Karl Marx se réjouissait de cette agitation perpétuelle et de l’ébranlement de l’ancienne société européenne par le « doux commerce ». Ils annonçaient à ses yeux l’avènement de la société post-bourgeoise, c’est-à-dire de l’utopie communiste. Ils annonçaient l’homogénéisation mondiale et la fin de l’histoire avec un grand H. Marx ne se trompait pas de beaucoup. A cette nuance près que le «doux commerce» s’est révélé finalement plus résistant, bien que tout aussi pervers que l’utopie communiste dont il réalise certaines attentes par d’autres moyens.
Convergence entre communisme et « doux commerce »
La conjonction des deux systèmes a été remarquablement analysée par Flora Montcorbier dans un essai injustement oublié (7). Economiste et philosophe, avec une clarté vigoureuse, cette essayiste a délivré une clé d'interprétation convaincante du chaos organisé qui s'est substitué à nos anciennes sociétés.
Nul avant elle ne s'était soucié de comprendre le curieux dénouement de la guerre froide, étape capitale du grand bouleversement. Qui était donc sorti vainqueur de cette fausse guerre ? Les Etats-Unis, bien entendu, et le « doux commerce ». Mais aussi leur religion commune, la religion de l'humanité (avec une majuscule), une, uniforme et universelle. Et ce n'était pas leur seule affinité.
Que voulaient les communistes ? Ils voulaient une gestion planifiée des richesses de l'humanité. Ils voulaient aussi la création d'un homme nouveau , un homme rationnel et universel, délivré de toutes ces « entraves » que sont des racines, une nature et une culture. Ils voulaient enfin assouvir leur haine des hommes concrets, porteurs de différences, leur haine de la vieille Europe, multiple et tragique.
Et le « doux commerce », autrement dit l’Occident américain (8), que voulait-il ? Eh bien, la même chose. La différence portait sur les méthodes. Récusant la planification et le collectivisme forcé (la terreur), le « doux commerce » voit dans le marché financier le facteur principal de la rationalité économique et des changements souhaités.
Le « doux commerce », autre nom du mondialisme, ne partage pas seulement avec son ex frère ennemi soviétique la vision radieuse du but final. Pour changer le monde, lui aussi doit changer les hommes, fabriquer l'homo oeconomicus de l'avenir, le zombi, l'homme nouveau, homogène, vidé de contenu, possédé par l'esprit du marché universel et illimité. Le zombi est heureux. On lui souffle que le bonheur consiste à satisfaire tous ses désirs, puisque ses désirs sont ceux que suscite le marché.
« Doux commerce » et immigration
Il y a pourtant des résistances. Mais comme le dessein est grandiose, on ne lésine pas sur les moyens pour les abattre. Afin de «zombifier» les Européens, jadis si rebelles, on a découvert entre autres les avantages de l'immigration de masse. Celle-ci a permis d’importer de la main d’œuvre bon marché, tout en déstructurant les identités nationales. L'installation à demeure d’allogènes accélère aussi la prolétarisation des travailleurs européens. Privés de la protection d'une nation cohérente, ils deviennent des « prolétaires tout nus », des zombis en puissance, d’autant qu’ils sont culpabilisés par le rappel de la colonisation, et autres forfaits imputés à leurs aïeux.
Une difficulté inattendue est venue cependant des immigrés eux-mêmes. Etrangers aux codes de conduite républicains, ils ont constitué dans les banlieues des communautés réislamisées, souvent rebelles au « doux commerce », hormis celui du shit. Dans leur univers, si l’on en croit les rapports officiels, la violence règne autant que le voile et la haine du policier. Une partie du territoire, jadis national, se trouve ainsi sous la menace d’émeutes endémiques. Celles-ci favorisent un transfert de la loi républicaine au profit de celle des « grands frères ».
Quant à la cohabitation avec les « Gaulois », il n’y faut pas trop songer, sauf au cinéma. Ceux qui n’ont pu fuir vers des quartiers moins envahis, se terrent, manifestant leur souffrance par des votes de refus quand l’occasion leur est donnée (9). Une conséquence imprévue est que la lutte des classes cède devant le partage ethnique. Le résidu des anciens conflits sociaux n’est plus le fait des prolétaires, mais de fonctionnaires accrochés à leurs privilèges.
Pourtant, il arrive que les indigènes en voie de « zombification » renâclent. Pour faire passer la pilule, le trait de génie du système a été d’utiliser les bons vieux staliniens et leurs pareils, tous plus ou moins recyclés dans la glorification du « doux commerce ». Ils fournissent l'important clergé inquisitorial de la religion de l'humanité, ce nouvel opium du peuple dont le foot est la grand-messe. Cette religion a ses tables de la loi avec les droits de l'homme, autrement dit les droits du zombi, lesquels sont les devoirs de l'homme. Elle a ses dogmes et son bras séculier, l’Otan et les tribunaux internationaux ou nationaux. Elle pourchasse le Mal, c'est-à-dire le fait d'être différent, individualisé, d'aimer la vie, la nature, le passé, de cultiver l'esprit critique, ne pas être dupe d’un écologisme de façade (réchauffement climatique), et ne pas sacrifier à la divinité humanitaire.
Le système se nourrit d’une opposition factice
L’une des particularités du système est qu’il se nourrit de son opposition en apparence la plus extrême. Mais quand on s’étonne de ce fait surprenant, on oublie que l’opposition dite « de gauche » partage avec le système la religion de l’humanité et la fringale de la déconstruction, donc l’essentiel. Ainsi, sans que personne ne s’esclaffe, les papiers d’un rebelle de tout repos (Guy Debord) ont-ils pu être classés « Trésor national » par le directeur des Archives nationales en juin 2009. Explication : le « doux commerce » a besoin de la contre-culture et de sa contestation pour nourrir l’appétit illimité du « jouir sans entraves » qui alimente le marché. La rébellion factice du monde culturel (les « cultureux ») a de la sorte été récupérée et institutionnalisée. Ses formes expérimentales les plus loufoques renouvellent le langage de la pub et de la haute couture qui se nourrissent de la nouveauté, du happening. Les droits des minorités ethniques, sexuelles ou autres, sont également étendus sans limites puisqu’ils se concrétisent par des nouveaux marchés, offrant de surcroît une caution morale au système. L’illimité est l’horizon du « doux commerce ». Il se nourrit du travail des taupes à l’œuvre dans la culture, le spectacle, l’enseignement, l’université, la médecine, la justice ou les prisons. Les naïfs qui s’indignent de voir célébrer de délirantes ou répugnantes bouffonneries, n’ont pas compris qu’elles ont été promues au rang de marchandises, et sont de ce fait à la fois indispensables et anoblies.
La seule contestation que le système ne peut absorber est celle qui récuse la religion de l’humanité, et campe sur le respect de la diversité identitaire. Ne sont pas solubles dans le « doux marché » les irréductibles qui sont attachés à leur cité, leur tribu, leur culture ou leur nation, et honorent aussi celles des autres. C’est pourquoi, en dépit de leur éventuelle représentativité électorale à l’échelle européenne, ces dissidents sont rejetés dans une inflexible ségrégation (sauf en Italie). Sort inconfortable qui pourrait les désigner comme seule alternative potentielle lorsque, devant l’urgence et l’inattendu, le politique reprendra ses droits (10). Dès lors, le « doux commerce » pourrait être ramené à la place subalterne et dépendante qui est la sienne dans un monde en ordre.
Dominique Venner
Notes
1. L’un des apports de Georges Sorel (1847-1922) à la pensée politique fut la notion de mythe pour désigner les images mobilisatrices autour desquelles se constituent les grands mouvements historiques (NRH 13, p. 20-22).
2.Article publié dans Le Monde du 30 décembre 2003, sous la signature de Gilles Bernheim, grand rabbin et philosophe, Elisabeth de Fontenay, professeur de philosophie, Philippe de Lara, professeur de philosophie, Alain Finkielkraut, écrivain et professeur, Philippe Raynaud, professeur de philosophie, Paul Thibaud, essayiste, Michel Zaoui, avocat.
3. On peut se reporter sur ce point à notre dossier La Chine et l’Occident, NRH n° 19, juillet-août 2005.
4. Georges-Henri Soutou, L’or et le sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Fayard, 1989. Nous avons traité ce sujet dans plusieurs dossiers, notamment dans nos n° 14 et 32.
5. Samuel P. Huntington, Que sommes-nous ? Indentité nationale et choc des cultures, Odile Jacob, 2004.
6. Dominique Venner, Le Siècle de 1914, Pygmalion, 2006, chapitre 10.
7. Flora Montcorbier, Le Communisme de marché, L’Age d’Homme, 2000.
8. Nous ne confondons pas le « système occidental-américain » et les Américains pris individuellement, qui souvent en souffrent.
9. L’analyse que nous avions faite de l’immigration de peuplement dans notre n° 22, janvier-février 2006, p. 29-32, conserve toute sa pertinence (dossier : De la colonisation à l’immigration).
10. « Le » politique désigne les principes supérieurs du pouvoir (commander, juger, protéger). «La» politique désigne la pratique.